
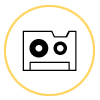
|
Jean-Jacques Goldman : "Forcément je tourne en rond" |
Un entretien avec le chanteur et auteur-compositeur français
le plus prospère
Jean-Jacques Goldman : "Forcément je tourne en rond"
Le Figaro, 29 septembre
1997
Quiconque a vécu en France dans les années 80 connaît les chansons de Jean-Jacques Goldman. Après dix ans d'une prodigieuse série de tubes (réédités tout ensemble sur le double CD Singulier 1981-1989, chez Columbia), il a su prendre le virage des années 90. D'abord, il a remis en question son statut de star en signant disques et tournées avec ses compagnons de scène, sous le nom de Fredericks, Goldman & Jones. Puis il est devenu le plus recherché des auteurs-compositeurs de la chanson francophone : l'album D'eux pour Céline Dion, des chansons pour Patricia Kaas ou Khaled, qui deviennent à leur tour des succès tellement énormes qu'on le croit prolixe, alors qu'il n'écrit qu'une demi-douzaine de chansons par an. Peu après la sortie d'En passant - un album en demi-teintes, en demi-joie -, il a accordé au Figaro une de ses rares interviews. Cette star singulière, qui vit toujours dans sa maison d'avant la gloire, tient à une vie discrète, à mille lieues de ce qu'on imagine d'un multi-millionnaire des variétés. Et il s'offre des plaisirs surprenants : ces jours-ci, il répète avant une courte tournée en tant que simple guitariste, derrière Gildas Arzel, l'ex-leader de Canada, qui vole maintenant de ses propres ailes et qui vient de sortir un album (chez Epic-Sony). Ainsi, avant une «vraie » tournée de Jean-Jacques Goldman, au printemps prochain, les Parisiens pourront le voir dans ses habits de musicien «de derrière » le 5 novembre au Café de la Danse.
Le Figaro : Nos lecteurs sont peut-être surpris de découvrir cet entretien en feuilletant Le Figaro sans qu'il soit largement annoncé en une. Pourquoi imposez-vous cette règle aux rares journaux qui peuvent vous interviewer ?
Jean-Jacques Goldman : Je suis d'accord pour que la presse spécialisée dans la chanson me mette en une, mais apparaître dans un quotidien avant cinquante-trois morts en Algérie, des élections en Pologne ou en Bosnie, ça me paraît obscène
Le Figaro : Votre nouveau disque, En passant, est signé Jean-Jacques Goldman, et non plus Fredericks, Goldman & Jones, comme les précédents. Pourquoi ?
Jean-Jacques Goldman : Pour les mêmes raisons qu'un jour il y a eu Fredericks - Goldman & Jones, alors que j'avais fait quatre ou cinq albums solo : avant, quand les chansons étaient venues, ce n'était que des duos et des trios, ce qui m'était jusque-là arrivé seulement avec une chanson par album - "Je te donne" avec Michael Jones, "Là-bas" avec Sirima. Alors, quand toutes les chansons ont été des duos ou des trios, je ne pouvais pas continuer comme si j'étais en solo. Cette fois-ci, après une vingtaine de chansons en duo ou en trio, j'ai écrit des chansons plus personnelles. Comme ce sont elles qui commandent, c'est un album de Jean-Jacques Goldman.
Le Figaro : Cet album est, sinon plus triste que jamais, du moins plus étroit, plus rétréci, plus grave.
Jean-Jacques Goldman : Il y a toujours eu deux tendances sur mes albums : des chansons très enthousiastes, très vivantes, avec des batteries fortes et des guitares fortes, et puis des chansons comme Veiller tard, par exemple, un peu plus introspectives. Quand j'ai commencé, j'avais vingt-neuf ans. Maintenant j'en ai quarante-six. Alors les batteries se calment un peu, l'introspection prend le pas sur le reste. Il me semble que c'est naturel, non ?
Le Figaro : C'est seulement une question d'âge ?
Jean-Jacques Goldman : C'est une question de vieillissement, je crois. Au tennis, c'est pareil, je monte moins à la volée qu'avant.
Le Figaro : Vous n'écrivez plus de grands hymnes comme Envole-moi ou Il suffira d'un signe ?
Jean-Jacques Goldman : A trente ans, on pense qu'on va «y aller ». A quarante-six ans, on ne sait rien. On sait qu'on raconte des histoires. (Rires)
Le Figaro : Vous avez le sentiment d'avoir raconté beaucoup d'histoires ?
Jean-Jacques Goldman : Pas d'avoir raconté des histoires mais d'y avoir cru – mais comme tout le monde, je crois, Si vous allez dans une mairie un samedi après-midi, vous allez voir neuf mariages. Si vous dites aux neuf jeunes couples, en région parisienne, deux mariages sur trois finissent par se séparer, les neuf vont répondre. « Oui, mais, nous, ce n'est pas pareil ». Alors que, statistiquement, quinze ans après, il y en aura six sur les neuf qui seront séparés ou en mauvais état, tous croient le contraire sur le perron de la mairie.
Le Figaro : Vous vous sentez encore capable de chanter sur scène tous ces grands hymnes que vous avez écrits dans les années 80 ?
Jean-Jacques Goldman : J'ai du mal. Pour « Quand la musique est bonne », ça va encore à peu près, mais j'avoue que c'est plus difficile pour une chanson comme « J'irai au bout de mes rêves ».
Le Figaro : Vous y êtes allé, justement ?
Jean-Jacques Goldman : Je n'ai jamais été un grand rêveur. J'avais des rêves atypiques.
Le Figaro : De quel genre ?
Jean-Jacques Goldman : Choisir, de ne pas être victime des nécessités de convention, des nécessités financières, géographiques. Choisir les gens avec qui je vis. Choisir mon emploi du temps. C'est des rêves très ambitieux.
Le Figaro : Et vous êtes arrivé à tout choisir ?
Jean-Jacques Goldman : Autant que possible. Si je ne faisais pas ce métier-là, mon loisir serait de faire de la musique, le samedi et le dimanche, chez moi, avec un petit ordinateur, des claviers, une guitare. Et j'enregistrerais des chansons comme d'autres jouent au bridge ou au golf.
Le Figaro : Est-ce que vous avez dû, à un moment ou à un autre, résister à la tentation de l'argent ?
Jean-Jacques Goldman : Non.
Le Figaro : Vous habitez toujours à Montrouge.
Jean-Jacques Goldman : J'ai été élevé comme ça. J'ai toujours su que les vrais plaisirs de l'existence sont assez bon marché. Ce que j'ignorais, en revanche, c'est que le monde des gens qui ont de l'argent était aussi pathétiques. J'ai vu les lieux qu'ils fréquentent, découvert leurs loisirs, écouté leurs conversations. Lady Di. qui est à Portofino et qui décide d'aller dîner le soir au Ritz, c'est d'un tel pathétique, d'une telle vulgarité.
Le Figaro : Vous n'avez jamais été tenté par ce mode de vie ?
Jean-Jacques Goldman : Jamais. Mais ça dépend si clairement de la façon dont on a été élevé J'ai toujours su que la richesse, c'est un Livre de Poche, un poulet grillé aux herbes de Provence par Mme Simone. une plage avec du soleil, un concert à 180 francs la place, un match de tennis avec un ami. Toutes les raisons de vivre sont bon marché.
Le Figaro : Qu'est-ce que vous faites de tout votre argent ?
Jean-Jacques Goldman : Pas grand-chose. D'abord, je ne suis pas allé vivre en Suisse ! Ce qui me permet de payer 60 % d'impôts sur le revenu, plus tout le reste ce qui me ravit. Plus j'en paye et plus je suis content
Le Figaro : Vous n'êtes pas du genre à vous plaindre du niveau de l'impôt.
Jean-Jacques Goldman : Non, parce que j'ai un rapport à l'argent un peu particulier. Je ne m'intéresse qu'à la liberté qu'il me donne - prendre un avion quand je veux, ne pas compter… Je suis conscient que, pour les entreprises, par exemple, il y a effectivement une révolution culturelle à accomplir, mais, en ce qui me concerne, les impôts ne me dérangent pas. D'ailleurs, je me trouve surpayé par rapport à ce que je fais.
Le Figaro : On peut supposer que, comme père de famille, vous avez placé pour vos enfants...
Jean-Jacques Goldman : Certainement pas, je trouve que la pire des saloperies que l'on puisse faire à des enfants, c'est d'en faire des héritiers. Il y a très peu d'enfants qui se sortent de cette sécurité de naissance.
Le Figaro : Vous pensez que vos trois enfants vous comprennent ?
Jean-Jacques Goldman : Absolument.
Le Figaro : Quel âge ont-ils ?
Jean-Jacques Goldman : De douze à vingt et un ans.
Le Figaro : C'est facile à vivre, d'être les enfants de Jean-Jacques Goldman ?
Jean-Jacques Goldman : Ça leur pose certainement des petits problèmes dans leurs relations avec les autres, mais moins que si leur père était alcoolique, violent, démissionnaire ou absent.
Le Figaro : C'est une chance d'avoir commencé votre carrière si tard ?
Jean-Jacques Goldman : Sur le plan de l'équilibre, oui. Je passe sur Michael Jackson, mais je sais ce que ça a fait à Johnny Hallyday d'être star à dix-sept ou dix-huit ans.
Le Figaro : Alors, justement, quand votre popularité a explosé, au début des années 80, quand vous aviez déjà plus de trente ans, l'adulation des adolescentes ne vous tournait pas la tête ?
Le Figaro : Non J'étais trop vieux, j'étais marié, j'avais déjà deux enfants.
Le Figaro : Quel effet cela vous a fait ?
Jean-Jacques Goldman : C'est ce qu'il y a de plus précieux. Maintenant, je fais un métier – je suis auteur de chansons, compositeur, arrangeur, musicien, interprète. A cette époque-là, je ne faisais pas un métier, c'était une chance inouïe de vivre ces relations affectives qui dépassent la raison. On a l'impression qu'on est les Beatles et Elvis Presley réunis. II y a des artistes qui ont une magnifique carrière sans jamais connaître ça.
Le Figaro : Et comment votre femme l'a pris ?
Jean-Jacques Goldman : Bien, je crois.
Le Figaro : Qu'est-ce qui a fait ce lien intime, quasi organique, avec ces centaines de milliers de gamins en France ?
Jean-Jacques Goldman : Je ne sais pas, et c'est ça qui est magnifique. Je venais de quinze ans de groupes de rock, j'avais fait trois albums avec Taï Phong, qui était un groupe très underground, j'arrivais avec II suffira d'un signe, qui n'est pas du tout une chanson adolescente, avec un album qui n'était pas un album adolescent, mais tout à coup ils m'ont choisi, Je ne sais pas pourquoi. II n'y a pas d'explication, c'est une espèce de rapport amoureux.
Le Figaro : A quel moment cette relation là a-t-elle commencé à changer ?
Jean-Jacques Goldman : Vers 1986-1987.
Le Figaro : Et qu'avez-vous ressenti ?
Jean-Jacques Goldman : Je me suis dit, voilà, c'est l'heure maintenant. Je savais que ça allait venir. Mais cela n'a pas été très douloureux, finalement. La tournée qui a eu le plus de succès, c'était après l'album Gris clair, gris foncé, en 1986-1987, et c'était déjà fini. Cette affection-là avait été remplacée par une autre attention, avec un public plus âgé et plus masculin. Je n'ai pas été une idole des jeunes qui tout à coup se retrouve nue, une fois qu'une génération d'adolescentes a grandi - puisque les jeunes filles ne mettent pas le même poster au mur que leur grande sœur. C'est un statut forcément éphémère, que vous vous appeliez 2 Be 3 ou Elvis Presley. Il se trouve qu'en faisant mon métier j'ai eu d'autres satisfactions, alors que ce rapport- qu'on pourrait dire amoureux - s'était naturellement terminé.
Le Figaro : Sache que je, le premier titre de votre album à passer à la radio, est une chanson plutôt désenchantée, assez dubitative quant à l'amour.
Jean-Jacques Goldman : Je ne suis pas d'accord. Le refrain est une déclaration d'amour. Simplement, il explique pourquoi il ne va pas dire : Je t'aime. C'est une chanson sur la forme mais pas sur le fond. Il ne dit pas qu'il y a mourir dans le fait d'aimer, mais qu'il y a mourir dans « je t'aime », qu'il y a du temps qui traîne dans je t'aime. Ce n'est pas douter de l'amour.
Le Figaro : Oui, mais il y a aussi sur ce disque « Les Murailles », qui est une chanson sur les illusions perdues dont l'amour.
Jean-Jacques Goldman : « Les Murailles » parlent des neuf couples de tout à l'heure devant la mairie, du fait que le mot «toujours » n'existe pas. Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise nouvelle.
Le Figaro : Ah bon !
Jean-Jacques Goldman : « Longtemps » ça peut exister. Le fait de savoir que « toujours » est une vue de l'esprit, ça donne un petit peu plus de précieux à « maintenant ».
Le Figaro : Rien ne dure toujours ?
Jean-Jacques Goldman : L'affection, l'amitié.
Le Figaro : Et la gloire ?
Jean-Jacques Goldman : Non, forcément non.
Le Figaro : Vous avez aimé la gloire ?
Jean-Jacques Goldman : J'ai joui d'être glorieux, j'ai eu l'impression d'une chance inouïe. Franchement, ça me suffit. Le respect m'angoisse. C'est le pire. C'est qu'on n'en a plus rien à foutre de vous. C'est exactement la différence entre les boys bands et Charles Trenet. Ça m'angoisse terriblement qu'on commence à me demander des préfaces, à m'inviter comme juré.
Le Figaro : Vous avez peur que ce moment arrive ?
Jean-Jacques Goldman : Mon problème, c'est que le plaisir dure, que j'ai encore envie. Alors ma question est de savoir par quoi je pourrais remplacer toutes ces heures passées avec un piano, une guitare, des musiciens, sur scène… Mais je ne suis même pas inquiet. Que ça dure sur le plan du succès, ça m'est vraiment égal, maintenant.
Le Figaro : Pourquoi cela vous est-il égal ?
Jean-Jacques Goldman : Ça n'a jamais été très important pour moi, les moments les plus importants, les plus intenses, sont ceux où une idée vient, où je compose une chanson, où je la construis, où je suis en studio. Après, dix mille personnes en train d'applaudir, c'est très agréable, mais très relatif par rapport à ces moments-là.
Le Figaro : II y a une douzaine d'années, vous aviez déclaré dans une interview que vous saviez que vous seriez un jour sur le déclin...
Jean-Jacques Goldman : Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule incertitude, c'est la date. Je ne vois pas pourquoi ce qui arrive à Barbara, Charles Trénet, Gilbert Bécaud, Bob Dylan ou Paul McCartney ne pourrait pas m'arriver.
Le Figaro : Quand vous écrivez, n'y a-t-il pas des moments où vous ressentez l'angoisse du déclin de votre créativité ?
Jean-Jacques Goldman : C'est un problème que l'on peut avoir si on a des échéances impératives. Quand mon contrat avec ma maison de disques m'imposait de sortir des disques à intervalle régulier, j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de chansons d'avance. Et ensuite, quand ce problème aurait pu se poser, je n'ai plus eu ces échéances contractuelles. Maintenant, je sors un album quand j'ai dix chansons de prêtes. Si ça n'avait pas été en août 1997, j'aurais sorti celui-ci en août 1998. Mais, plus globalement, je me rends compte que mes idées viennent de moins en moins facilement sur le plan de la musique - c'est naturel, comme les rhumatismes. Je ne pense pas commencer à faire du rap ou de la techno maintenant, et je tourne forcément en rond, comme tout le monde. Par contre, je prends de plus en plus goût aux textes des chansons, et je me rends compte qu'il y a des terrains à explorer, auxquels je n'aurais pas forcément pensé au début.
Le Figaro : Vous vous étiez rendu compte qu'une partie de la mélodie est identique sur « Aïcha », que vous avez composée pour Khaled, et sur « Les derniers seront les premiers », que chante Céline Dion ?
Jean-Jacques Goldman : Non, je m'en suis rendu compte quand on me l'a dit. Mais, pendant la première tournée que j'ai faite, je chantais deux chansons, « Le Rapt », qui est sur mon premier disque, et « Minoritaire », qui est sur le deuxième album. Aucun musicien ne s'en est rendu compte, le public ne l'a jamais dit, et je ne m'en suis pas rendu compte moi-même, mais la mélodie des deux chansons est absolument identique. L'ambiance, la thématique, le texte et les arrangements sont différents, mais on m'a fait remarquer il y a deux ans que c'était la même mélodie. On s'en rend mieux compte avec « Aicha » et « Les derniers seront les premiers » parce que ces chansons ont été des succès.
Le Figaro : Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous aviez cristallisé une telle détestation de la part d'une bonne partie de la presse dans les années 80 ?
Jean-Jacques Goldman : C'est un acte banal de racisme, absolument ordinaire. Ça a été exactement la même chose que le fait que, actuellement, la quasi-totalité de la critique déteste les boys bands. S'il y a une bonne chanson sur un album de 2 Be 3 ou de Worlds Apart, elle n'a aucune chance d'être détectée. S'il y a un bon chanteur dans le groupe Alliage, il n'a aucune chance d'être repéré par la presse. Il est politiquement correct de dire que les boys bands sont nuls. Ils sont préjugés, c'était la même chose pour moi. J'arrivais, j'étais mignon, je chantais avec une petite cravate, il y avait des jeunes filles qui criaient, je chantais avec une voix très juvénile, je n'avais aucune chance que quelqu'un écrive que j'avais écris une bonne chanson avec « Pas l'indifférence » ou « Veiller tard ».
Le Figaro : Les chansons d'« En passant » sont plutôt intimes. Cette tendance-là n'a-t-elle pas été contrariée, chez vous, par les nécessités des tournées dans des grandes salles, qui vous aurait conduit à écrire des chansons qui convenaient à ce cadre ?
Jean-Jacques Goldman : Vers Gris clair, gris foncé, je me suis rendu compte que je commençais à être dépassé, en particulier sur les rythmiques - mes morceaux rapides commençaient à dater, à sonner un peu vieux, des amis m'ont aussi fait remarquer que j'avais beaucoup de progrès à faire sur le plan de l'arrangement, A partir de là, j'ai commencé à travailler avec des arrangeurs, et j'ai fait des expériences vers une production plus sophistiquée, en particulier sur le précédent album, Rouge. Plus tard, je me suis rendu compte que mes compositions demandaient en fait un arrangement très simple.
Le Figaro : Même la chanson Rouge, votre hymne à l'idéal marxiste défunt ?
Jean-Jacques Goldman : Non, elle est plutôt cohérente dans son côté péplum, comédie musicale.
Le Figaro : Votre père était communiste en rupture de PCF. On a compris dans Rouge que vous aviez le regret de ce grand idéal.
Jean-Jacques Goldman : J'ai le regret de cette simplicité, de cette tranquillité. J'envie un peu les militants des années 20 à 30. Le monde était simple, il y avait, d'un côté, les gentils, la vérité absolue et la logique, et, de l'autre, les méchants. C'était assez confortable.
Le Figaro : Et maintenant, où sont les gentils ?
Jean-Jacques Goldman : A mon avis, les gentils sont derrière une idée très neuve et qui demande à être détendue, qui est celle de la république. Trois mots - Liberté, Egalité, Fraternité – qui restent être pleinement vécus.
Le Figaro : Vous votez toujours ?
Jean-Jacques Goldman : C'est à peu près mon seul acte politique.
Le Figaro : Vous n'aviez jamais caché votre admiration, votre affection pour Michel Rocard. Il vous manque dans le paysage actuel ?
Jean-Jacques Goldman : II me semble que, finalement, il a gagné. Il doit se reconnaître dans ce qui se passe actuellement.
Le Figaro : Vous avez déjà chanté à la Fête de l'Huma ?
Jean-Jacques Goldman : Jamais. On me l'a encore proposé cette année. J'ai répondu que j'étais un anti-PCF primaire, secondaire et tertiaire. Ce n'est pas un hasard si je n'ai jamais chanté à la Fête de l'Huma.
Le Figaro : Vous leur en voulez toujours ?
Jean-Jacques Goldman : Je ne leur en veux pas, je ne comprends pas. Il y a des gens très attachants au Parti communiste français, mais aussi une histoire qui est trop lourde.
Le Figaro : Vous êtes toujours de gauche ?
Jean-Jacques Goldman : Si la gauche, c'est Rocard, et la droite, c'est Mouillot, je suis de gauche. Si la gauche, c'est Tapie, et la droite, c'est Séguin, je suis plutôt de droite. Je suis plus fidèle aux principes qu'aux hommes et aux structures. Quand les hommes trahissent vos principes, il faut les lâcher. Le Parti communiste soviétique promettait le changement de la nature humaine, la justice, le pouvoir aux travailleurs. Il fallait avoir la force, comme l'a eue mon père, de dire que ces gens-là trahissaient les principes.
Le Figaro : Intimement, profondément, vous vous sentez de quelle appartenance ? Français, juif ashkénaze, fils de la banlieue sud ?
Jean-Jacques Goldman : Je me sens bien avec les musiciens, ils sont ma famille - j'ai fait une chanson là-dessus, « Famille ». Quand j'étais enfant, à la maison, la religion était « l'opium du peuple » c'était écrit à la première page du livre. J'aurais bien aimé appartenir à la religion juive, je crois. Mais j'en ignore tout, je suis entré deux fois dans une synagogue, dont une fois l'année dernière. Je voudrais vraiment beaucoup me sentir français, parce c'est le groupe dont l'histoire et les caractéristiques m'attirent le plus, même si elles sont parfois agaçantes. Mon père est parti dans les années 20 de Pologne, et il aurait pu atterrir n'importe où, aux Etats-Unis, au Canada, en Israël, en Afrique, en Amérique du Sud. Si j'avais dû choisir où il devait s'arrêter, j'aurais choisi la France.
Le Figaro : Vous employez le conditionnel pour parler de votre appartenance à la France.
Jean-Jacques Goldman : Je vis comme mes parents avec toujours une toute petite angoisse. On sait que quelqu'un pourrait toujours… et on le lit dans certains programmes. Je suis né en France, j'y suis allé à l'école, et ma langue natale est le français. Je ne sais pas si je suis d'ici, mais je ne suis de nulle part ailleurs, en tout cas.
Retour au sommaire - Retour à l'année 1997